« Soft As Snow (But Warm Inside) », en présentant de manière claire la batterie de Colm Ó Cíosóig, la basse de Debbie Googe et le chant de Kevin Shields, commence à poser les bases d’un album qui dépassera déjà l’influence de
Sonic Youth et de Jesus & Mary Chain. Entre l’hommage et l’émancipation, fort et subtil en même temps, « Isn’t Anything » peut s’écouter en boucle tellement l’ambiance coule de source dans un équilibre accompli entre variations et homogénéité.
Ce qui distingue
My Bloody Valentine de ses prédécesseurs, outre les accélérations de la batterie par intermittence et le recours à la répétition d’un même accord de guitare (qui n’empêche ni les contrastes, ni la beauté des arrangements), c’est une exploration complexe de la dualité vocale entre le chanteur et Bilinda Butcher, depuis la complémentarité immédiate jusqu’à la compartimentation, en passant par l’alternance, les chœurs ou le contrepoint, tout en jouant de l’ambiguïté sonore introduite par l’usage de samples bruyants, ensemble de procédés ayant pour horizon une perception du chant relevant de la transcendance à travers l’atténuation : plutôt que de montrer l’importance des éléments à la fois mélodieux et signifiants en augmentant leur volume, on les fait au contraire mieux ressortir quand on les enfouit sous les autres instruments.
C’est ainsi que « Lose My Breath » complète les fondations de l’album : la chanteuse, elle aussi guitariste, amène son caractère à la fois plus charnel et plus éthéré.
Au-delà de ces deux premiers titres, les guitares, telles des scies mécaniques («
Feed Me with Your Kiss »), prennent de l’ascendant sans pour autant contredire les bases de l’opus (« Cupid Come »), d’autant plus que ce dernier évolue en introduisant, de manière intelligente, de nouveaux moments calmes (« No More Sorry », « All I Need », « Several Girls Galore », « I
Can See It But I
Can’t Feel It »).
Le résultat est un continuum qui défie l’évidence, résistant à l’écoute et permettant à l’auditeur d’y découvrir des nouveautés à chaque fois, ce résultat remarquable étant servi par le naturel, la décontraction et la régularité avec lesquels les deux vocalistes se fondent dans le décor sonore (« When You Wake You’re Still in a Dream », « Sueisfine »).
Quant aux guitares, la synthèse paradoxale qu’elles opèrent entre la recherche de la finesse et le goût de l’extrême («
Nothing Much to Lose », « You Never Should »), à la manière d’outils aussi précis que tranchants, font de
My Bloody Valentine l’un des exemples privilégiés qui permettent de comprendre en quoi la distorsion a en quelque sorte remplacé, à l’échelle du rock, ce que la présence massive de l’orchestre incarnait dans la musique classique.
Des adaptations instrumentales de leurs albums pour des ensembles symphoniques seraient encore à réaliser (on connaît par exemple la version d’ «
Only Shallow » de Walt Ribeiro). Ce ne serait pas que de la musique répétitive, car on n’a pas fini de prendre conscience de toute la richesse de leur son, l’une des principales raisons pour lesquelles les productions de ce groupe tolèrent aussi bien l’épreuve du temps, près de trente ans plus tard et probablement au-delà.
Quand on aime la musique, leurs disques sont de vrais trésors. « Isn’t Anything », qui ne promet rien mais tient toutes les promesses qu’il aurait pu faire, reste l’introduction idéale de «
Loveless ».
D. H. T.
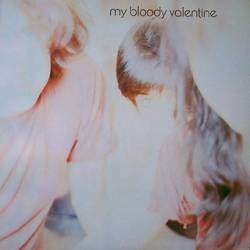
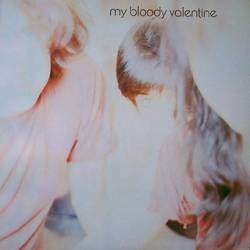 My Bloody Valentine : Isn't Anything
My Bloody Valentine : Isn't Anything












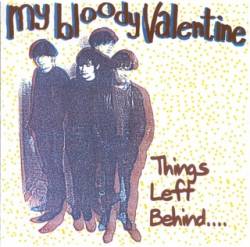


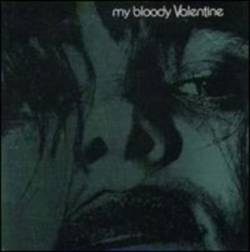
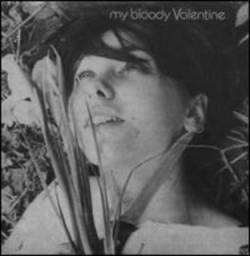


/Man You Love to Hate (Live).jpg)

Vous devez être membre pour pouvoir ajouter un commentaire