Dès les premières paroles qui ouvrent «
Horses » (produit par John Cale, lui-même secondé par Bob Ludwig, connu pour son éclectisme inspiré), « Jesus died for somebody’s sins but not mine », outre une revendication individualiste salutaire, un parfum de liberté, on sent que «
Gloria », musicalement, se promènera quelque part entre la country et ce qui allait devenir le punk rock, mais aussi qu’une bonne impertinence, celle qui consiste en somme à ne pas demander l’autorisation de respirer, guidera l’album jusqu’au bout. Difficile de ne pas connaître l’un des refrains les plus accrocheurs du rock en général, maintes fois repris d’une génération à l’autre en toute occasion. Néanmoins, si c’était le cas, on ne se douterait pas, avant d’entendre ce refrain universel, que la chanson atteindrait un tel degré d’assurance charismatique, déployée pour emporter spontanément tous les suffrages via sa bonne humeur festive. Son message ne remet fondamentalement pas en cause les croyances sincères de ceux qui vivent leur spiritualité comme un épanouissement, il ironise légèrement sur la dérive oppressive de certains dogmes. «
Gloria » est une chanson de la modernité, une modernité certes consumériste par certains aspects, qui a également le mérite d’affirmer la légitimité des voix singulières, comme la simple revendication d’un droit de vivre.
Le reggae de « Redondo Beach » participe de cette universalité culturelle, révélateur d’un nomadisme où l’expressivité vocale atteste une identité reconnaissable, une vibration intérieure permanente, une écorchure de l’âme, la même écorchure de l’âme que l’on retrouve exacerbée dans le théâtral autant que monumental « Birdland », exemple de l’influence que
Patti Smith a pu avoir sur
Kate Bush, avant que
Patti Smith ne soit, plus tard, influencée par
Kate Bush en retour. L’intensité progressive de «
Free Money » ajoute le hard rock aux références pour compléter le tableau, laissant « Kimberly » esquisser une synthèse discrète, légère et feutrée, des explorations précédentes. Le haut fait d’arme de « Break It Up » consiste bien sûr dans le duel entre le chant de
Patti Smith et la guitare de Tom Verlaine, mais aussi dans les notes de piano mystérieuses qui ne laissaient pas deviner, a priori, un tel déchaînement. C’est à la limite de la folie que « Land » mène les chevaux en question, des chevaux sauvages sur une terre infinie. La poésie du texte, à partir de la quatrième minute, emprunte la sobriété de la parole, et
Patti Smith, faisant écho à elle-même, commente sa chanson dans un tourbillon vocal qui épouse la forme du rythme, quelques accords de blues en fond sonore. « Elegie » s’insinue avec lenteur, à l’image de l’alcool dans lequel se noient les sombres pensées nocturnes, et cette fois c’est la guitare d’Allen Lanier qui répond. La reprise punk de « My Generation » des Who, avec un son live digne d’une flaque d’huile de vidange, revient brutalement au point de départ de l’album, dans une explosion finale.
D. H. T.
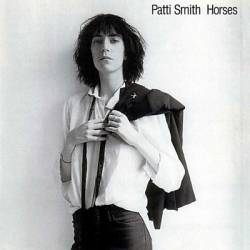
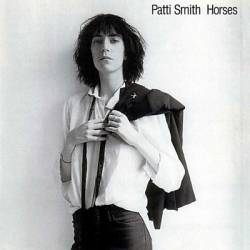 Patti Smith : Horses
Patti Smith : Horses












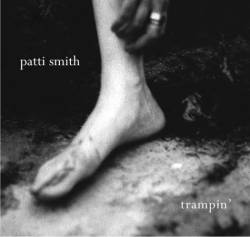








Vous devez être membre pour pouvoir ajouter un commentaire