La tentation serait grande de faire un procès d'intention à l'égard de
Steven Wilson, quand on sait que le Einstein du prog sans moustache mais à lunettes ne vibre plus pour la guitare.
D'ailleurs, accusé
Steven Wilson, levez-vous. Veuillez écouter les chefs d'accusation. Délaissement de guitare, incitation à la dance, détournement de fans, utilisation de synthétiseurs à des fins mercantiles, et... mort du Rock.
Bon, j'exagère, un génie ne fait jamais rien de musicalement condamnable, surtout s'il va précisément dans la direction qu'il a choisie, en son âme et conscience. Mais tout de même, son dernier album "
To the Bone", malgré l'enthousiasme que la découverte de toutes ses strates avait provoqué chez moi, est au final l'album du divin blondinet que j'ai le moins envie de réécouter. S'était-il trop délayé dans la pop, genre qui ne me fait pas lever les poils, même s'il y excelle ? Ou pouvait-on déjà sentir que le ver était dans le fruit et que ça allait dégénérer dans la mélodie et les bons sentiments ?
Le petit
Steven Wilson, né à Hemel Hempstead en Grande Bretagne, a eu une enfance heureuse dans l'amour du Prog, que ses parents lui ont inculqué dès le plus jeune âge. Bien qu'il se soit montré réticent à la pratique de la guitare, il a monté Altamont, un duo de musique synthétique psychédélique, puis a retrouvé le droit chemin avec Karma, groupe de rock progressif de sa ville natale. En 1986,
Steven Wilson lança deux nouveaux projets avec lesquels il allait faire sa notoriété :
No-Man, expérimentations d'électro et pop, et surtout
Porcupine Tree, avec lequel il commit dix albums studio. Il a aussi collaboré en tant que musicien ou producteur avec de nombreux artistes de renommée internationale (
Marillion, Opeth, OSI, Orphaned Land,
Yoko Ono,…). Vous noterez que, fait particulièrement dérangeant, Monsieur Wilson a aussi été l'auteur de chroniques de disques, pour un magazine dont je tairai le nom. Chroniqueur, oui, messieurs les jurés, je vous laisse méditer cette information.
Depuis 2003, le dénommé Wilson est devenu son propre patron, publiant sous son nom plusieurs albums, jusqu'au sixième album que nous jugerons aujourd'hui, "
The Future Bites".
Je laisse la parole à l'accusation :
Il faut se rendre à l'évidence, le temps de
Porcupine Tree est révolu, et
Steven Wilson semble avoir perdu la foi dans le bruit et la fureur du Rock et des guitares. Mais pas que. Il semble que le grand blond avec des lunettes noires ait perdu le petit Pape du Prog qui était en lui, ou plutôt l'a-t-il attaché à un piquet sur une aire d'autoroute, repartant pour de nouvelles aventures artistiques, sans un regard en arrière. Sans compter qu'il a chopé la saloperie qui a décimé l'année 2019 - 2020. Pas celle que vous croyez, je parle de la maladie qui enlève tout goût à la six-cordes, et transforme nos rockeurs préférés en bidouilleurs de l'électro. Tel une amante revenue des frissons de l'amourachement, il avoue avec simplicité l'indifférence qu'il ressent dorénavant à l'égard de la guitare. Plus aucun goût, messieurs-dames, regardez comme son regard est froid, vide et métallique… Je n'ai plus rien à dire, les preuves jointes au dossier, figurant neuf morceaux, parleront mieux qu'aucun réquisitoire.
Le jury est disparate, composé de fans de tous âges et de tous milieux socio-professionnels. Certains sont amers, d'autres pardonneront tout, et quelques-uns sont tout acquis à sa cause. Si les adeptes du Watt Sacré ne jurent que par un "
Fear of a Blank Planet", de
Porcupine Tree, ou "The Raven That
Refused to Sing" en solo,
Steven Wilson a toujours eu un registre musical extrêmement large, donnant à chacun de ses albums une couleur différente. Donc, au final, personne ne peut dire qu'il ne savait pas.
Sur son avant dernier album en date, "
To the Bone", le virage pop était prononcé, et le très dansant "Permanenting" avait été provoqué moult chamailleries dans le bac à sable des forums. Des critiques et des déceptions de fans,
Steven Wilson n'en a cure, et il a bien raison. Puisque la guitare est devenue une sorte de feuille blanche et muette, il est revenu à ses premières amours : le bidouillage, l'expérimentation. Il suffit de regarder les vidéos des "Future Bites Sessions", qui contiennent des version brutes et aussi d'autres morceaux non présents sur l'album pour deviner que Steven a laissé libre cours à ses instincts les plus joyeusement infantiles, ceux qu'il avait en découvrant la musique. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la froideur et la perfection du son en titane de l'album, très peu de choses ont été enregistrées avec du plugin numérique. On le voit jouer avec des instruments aussi divers que l'auto-harpe, la boites à rythme, l'orgue hammond, le mellotron et toutes sortes de synthétiseurs avec plein de boutons compliqués dessus. Il y a tout de même des instruments classiques rock, batterie, basse, et guitare claire ou sèche, mais la plupart du temps tellement traités qu'ils sont méconnaissables en tant que tels, à l'exception des morceaux plus pop comme "12 Things I Forgot", "Eminent Sleaze", ou "Follower", où on retrouve des sonorité familières.
En effet, dès la deuxième piste "Self", on trouve un Steven perché dans des aigus Bee Gees, qui se dandine sur un rythme dance/disco avec de malicieux choeurs féminins, et on se demande si on a pas par inadvertance le nouveau
No-Man entre les pognes. Le single "Personal Shopper" est ainsi une longue déambulation disco dans un hypermarché froid comme une salle d'opération, où
Elton John himself énumère les instruments de torture consuméristes qui dissèquent les consommateurs que nous sommes, anesthésiés dans une douce euphorie. La coloration générale est très électro, dans la production de Steve Wilson et David Kotzen (qui a activement participé à l'album, à la programmation) comme dans les effets et traitements appliqués. La batterie est réduite à la plus simple expression du beat, même si la plupart du temps Michael Spearman est en charge des baguettes, et parfois simplement pour assurer le charley.
L'autre grande tendance qui se dessine pour ce cru 2021 est l'hommage pop, avec des revisites à la manière d'
Elton John sur "12 Things I Forgot", ou le pop/rock de "Eminent Sleaze", sorte de Best Of d'
INXS, qui louvoie comme le faisait le "Devil Inside", avec une basse très ronde et présente à la "Original Sin", et qui pousse le mimétisme avec le même genre de delay ping pong très court sur la voix. On pense aussi parfois à
Muse époque "The 2nd Law", sur très réussi et touchant "King
Ghost", ou on trouve la même vibe synthétique et organique à la fois. L'album se termine sur "Count Of Unease", planant, sombre et nostalgique, qui me rappelle énormément le travail du cinéaste David Lynch avec Angelo Balamenti sur Twin Peaks. On retrouve des claviers chevrottants très typés 80's, et de belles notes de piano un peu dans l'ambiance de l'album "
Hand. Cannot. Erase".
De toute évidence, Sir Wilson s'amuse comme il n'aurait pas osé le rêver à ses débuts, à triturer, dissoudre les sons. Il joue avec les durées des compositions, parfois très (trop) courtes comme la très belle introduction "Self" qui fait à peine plus d'une minute, ou à l'inverse il étire un morceau très simple, froid et répétitif comme "Personal Shopper" à plus de neuf minutes, sans qu'on voie le temps passer. Comme un gosse de douze ans qui pète ses ex-meilleurs jouets, Steven martyrise les rares passages de guitare électrique, sous forme de soli, ou des bouts de soli, tous pétés, avec un son digne d'une craspec Metal Zone II qui déchire d'un coup de cutter le bel ordonnancement du mix.
Heureusement, il reste la superbe voix de Steven, et ses idées de mélodies lumineuses. Elle tranche avec la précision clinique de la musique, et semble totalement libérée des carcans des genres musicaux. Il fait des merveilles, tout en sensibilité sur "King
Ghost", félin sur "Eminent Sleaze", entrainant sur "Follower".
Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de prog : il y en a pas. Et difficile de dégoter une miette de metal alors qu'on ne trouve pas une once de rock sur tout le disque. Quelque chose me manque dramatiquement sur cet album, et c'est en réécoutant les précédents LP "
Hand. Cannot. Erase" et "
To the Bone" que j'ai enfin pu mettre le doigt dessus. On entend plus des mecs jouer. C'est comme un arbre majestueux qu'on aurait remplacé par un espace "minéral" dans une mégalopole, où les rares oiseaux qu'on trouve encore sont les cadavres de ceux qui se sont écrasés sur les façades de verre des buildings. La virtuosité instrumentale qui éclaboussait de classe chaque album du divin blond n'est qu'un lointain souvenir, et j'avoue que j'espère qu'on pourra se rabattre sur de prochaines versions live (en 2022 ? 2028 ?) pour retrouver cette sensation et cette énergie de groupe...
L'heure du verdict a sonné, et nous avons délibéré de longues heures, mon cerveau reptilien, ma nostalgie de gamin des années 70 de et mes oreilles de bourrin. Le contenu très électronique et pop de ce "
The Future Bites" n'est pas une surprise, quand on suit l'évolution de notre briton préféré depuis quelques albums, si ce n'est qu'il est arrivé de manière bien plus radicale qu'attendu. Avec l'impression de faire le deuil d'un
Steven Wilson tué par
Steven Wilson. Son nouveau "Self" n'a rien perdu de son génie, ni de sa pertinence, ni de sa créativité. "
The Future Bites" est comme un miroir glacé qui diffracte les rayons du passé, du présent et du futur, et vous renvoie à votre reflet ridé et vieilli dans une matrice de mégabits. L'acquittement sera la sentence la plus sage : difficile de condamner une création qui correspond aussi profondément et librement aux souhaits de son auteur, d'autant plus qu'elle touche des cordes nouvelles alors que les anciennes ne vibrent plus.

 Steven Wilson : The Future Bites
Steven Wilson : The Future Bites











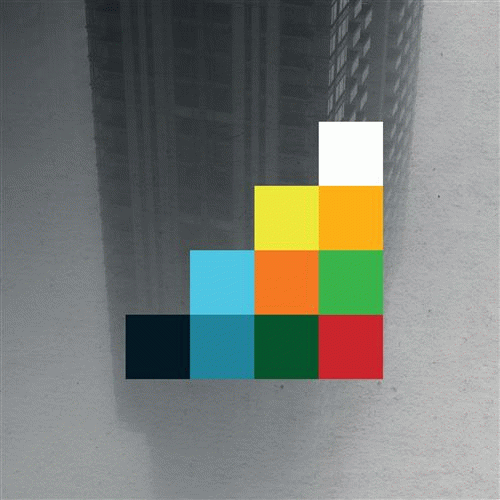



/The Raven That Refused to Sing (And Other Stories).jpg)




Plus de 4 ans après sa parution, j'ai enfin découvert ce disque si controversé de SW. Je m'attendais fébrilement a un truc tellement froid et désincarné que ma surprise n'en aura été que plus grande. Car OUI, ce disque est vraiment bon. Indéniablement. Au diable donc les comparatifs stériles, cette Pop, tantôt électro, ambiante, atmosphérique, disco/funk et j'en passe, m'enchante. Quand bien même nous sommes ici à 1000 lieux du style qui l'aura rendu si respectable de la part des Progeux et autres Métaleux de tous poils.
Ton com rend parfaitement compte de ce qu'est cet album atypique. Soit en pleinement remercié.
Vous devez être membre pour pouvoir ajouter un commentaire