Il est tard, je trace la route.
Je double des camions. J'allume une cigarette. Je monte le son de l'autoradio...
Mais cet album de
Kiss censé me maintenir éveillé n'a plus de secrets à me révéler : entre nous deux, ce soir, c'est la routine. Je l'écoute sans l'écouter. Et mes pensées se perdent le long des ombres dessinées sur la route par les phares des quelques voitures que je croise... C'est dans ces moments hors du temps que les questions existentielles m'assaillent, et, en passant à côté d’une camionnette blanche devant laquelle j'ai le temps d'apercevoir une junkie peinturlurée au regard vide, j’ai un flash et je m'interroge...
Reste-t-il encore quelques fans de
Styx sur cette planète ?
Même si elle ne devient véritablement sérieuse qu’en 1972, l’aventure du combo débute dès 1961, lorsque les jumeaux Panozzo, alors âgés de 13 ans, s’acoquinent avec leur voisin Dennis DeYoung, 14 ans, pour former un «vrai groupe de Rock». Les frangins, qui pratiquent leurs instruments depuis l’âge de 7 ans, jouissent alors d’une solide réputation dans le circuit des mariages / birthday-parties de
Chicago-Sud, mais le temps est désormais venu de laisser tomber les reprises de Frank Sinatra pour passer la vitesse supérieure… Chuck tient la guitare et John martèle les fûts, tandis que Dennis, chanteur-claviériste, fronte le teenage-band. Le groupe suit le parcours du combattant des rockstars-en-devenir en affrontant les habituels changements de nom («The Tradewinds» puis «TW4») et de line-up… Chuck, adolescent mal dans sa peau, s’exile notamment une année dans un séminaire, et renonce finalement à la prêtrise pour devenir bassiste en 1964, sa place de guitariste ayant été offerte à Tom Nardini durant son absence.
Les années passent mais les jeunes s’accrochent, si bien qu’ils enregistrent à partir de 1972 une série d’albums sous contrat local avec Wooden Nickel Records, disques qui passeront quasiment inaperçus. Il leur faudra attendre 1975 pour que «Lady» se hisse à la sixième place des charts US grâce à des passages radio récurrents. Ce succès inespéré deux ans après la sortie du morceau permet aux illinoisais de décrocher un nouveau contrat chez A&M et de relancer une carrière au point mort. Il est pourtant fort probable que
Styx aurait rapidement sombré dans l’oubli si leur soliste JC, de son vrai nom John Curulewsky (
RIP 1950-1988), n’avait pris en décembre 1975 la difficile décision de quitter le groupe afin de se consacrer à sa famille.
Ce départ imprévu tombe très mal car les musiciens, décidés à s’imposer à l’Amérique, doivent partir en tournée dans les jours qui viennent : il leur faut donc trouver d’urgence un guitariste doué capable de surcroît d’assurer des harmonies vocales complexes... «Rester calme, ne pas paniquer, réfléchir…
Hey ! MS Funk ! Oui, c’est ce mec de MS Funk qui va nous sauver, vous vous rappelez les gars, ce groupe en résidence au «
Rush Up» qui cassait la baraque le mois dernier ? Le soliste chantait aussi bien que le frontman, bordel !» C’est grosso modo les mots qu’échangent Chuck, John, Dennis et leur guitariste
James Young avant de passer quelques coups de fil pour apprendre le split de ce combo désormais oublié dans lequel le regretté Fergie Frederiksen (
RIP 1951-2014 /
Toto, LeRoux) tenait le micro. Renseignements supplémentaires pris, le jeune axeman qui a marqué les esprits se nomme Tommy Shaw, et il est reparti dans son
Alabama natal pour y fonder un nouveau band du nom d’Harmony. Un coup de bigophone plus tard, Tommy saute dans un avion et revient à
Chicago avec son flightcase. Il ne l’ouvrira même pas lors de la courte audition durant laquelle Dennis lui fera simplement chanter «Lady». Le newkid peut atteindre les notes les plus aigües, il peut monter dans le bus !
Cette redistribution des cartes à priori insignifiante va faire basculer la destinée de
Styx : les frères Panozzo viennent de piocher l’atout qui leur manquait pour créer de grandes choses. Tommy va en effet sensiblement, finement, faire évoluer
Styx en insufflant un sens du morceau, un soupçon d’énergie et peut-être même une pointe de magie à la déjà-inimitable trademark Dennis DeYoung. Les compositions du groupe, jusqu’alors trop pompeuses et, avouons-le, finalement un peu chiantes, décollent enfin; preuve s’il en faut le palier franchi par «
Crystal Ball» (1976), premier opus du nouveau line-up. Le talent exceptionnel de Tommy pour arranger des morceaux et en faire des hits ne restera d’ailleurs pas très longtemps méconnu et il utilisera son temps libre dans les 90s à écrire pour les autres. Certains noms vous diront peut-être vaguement quelque chose , je citerai entre autres
Alice Cooper («It’s Me» – 1994, tiré de «The Last Temptation»),
Aerosmith («Shut Up And Dance» - 1993, tiré de «Get A Grip» et «Walk On Water», issu de la même session mais sorti en 1994 sur la compilation «Big Ones»), Vince Neil («You're Invited But Your Friend
Can't Come» – 1993, tiré d’«Exposed») ou encore le
Prince Of Darkness himself avec qui il écrira «Whole World's Falling Down», titre finalement écarté de la tracklist finale d’«Ozzmosis» en 1995…
Mais nous sommes pour l’instant en 1977, année musicalement marquée par deux mouvements radicalement antithétiques puisque le raz de marée Punk («Never Mind The Bollocks », «L.A.M.F.», «Damned Damned Damned», «
The Clash », «Leave Home» / «Rocket To Russia»…) crache à la gueule du Rock Prog à son apogée (Yes-«Going For The One»,
Genesis-«Seconds Out (Live)»,
Camel-«Rain Dances»,
Kansas-«Point Of Know Return» et surtout les über-référentiels «A Farewell To Kings» et «Animals» de
Rush et
Pink Floyd)… C’est le 7/7/77 -bien vu- qui est choisi pour officialiser la sortie du septième opus de
Styx, qui n’a évidemment rien de Punk mais qu’il est impossible de classer dans le Prog par purisme, les musiciens s’abaissant lamentablement à tenter de vendre des disques ! Quelle idée franchement ! Les journaleux, désemparés, inventent même une nouvelle étiquette pour désigner ce Rock-progressif-mais-commercial : le… «Pomp Rock»... Faut-il se fendre d’une description ou tout le monde imagine, mis à part le gars qui regarde son écran en pensant à une basket Nike ? Allez rien que pour lui, on fait l’effort ! C’est simple : des titres épiques, techniques, englués sous une épaisse couche de synthé, progressifs en somme, mais pourtant facilement mémorisables grâce à un feeling pop très prononcé. Inutile d’ajouter que les chanteurs sont des ténors et qu’ils placent des harmonies vocales partout où il est possible d’en mettre, si ? Et j’allais oublier le plus beau (ou le plus étrange peut-être) : ces disques sont en 1977 susceptibles de cartonner auprès du public mainstream… Et c’est ce qui arrive d’ailleurs à
Styx après seize années de galères puisque «
The Grand Illusion» s’incruste dans le foyer de plus de 3 millions d’américains, atteignant ainsi la sixième place du Billboard 200…
OK. Tu veux des explications. Je te connais, tu viens d’aller écouter un morceau sur YouTube qui t’a fait sursauter, t’as peut-être même été voir la gueule des gars à cette époque, et t’as besoin d’en parler pour éviter le trauma psy. Faut bien avouer que la back-cover en plus d’être un montage photo catastrophique apparemment conçu au ciseau et à la colle sur une table de cuisine est particulièrement effrayante… Le look «Petite Maison Dans La Prairie» de Tommy, les bottes d’équitation de
James, le nœud pap’ de Dennis et la boule afro de John; tout ça ajouté au fait que les gars sont cachés derrière des arbres sortis d’un mauvais décor de kermesse, ce qui laisse immanquablement penser de nos jours à un rassemblement de pédophiles à l’affût dans la forêt; ouais ça fait beaucoup. Et puis tu te dis qu’à première écoute, la musique semble avoir été écrite pour quatre catégories de personnes seulement : les filles / les mecs assis à côté d’elles qui font semblant de kiffer pour conclure / les gays / les romantiques incurables (non ils ne sont pas tous gays)… Mais tout ça, c’est parce qu’on est en 2014-de-merde, parce que tu n’as pas de cœur et parce que tu ne comprends rien ! Il faut que tu saches qu’écouter «
The Grand Illusion», pour quelques cas que la médecine étudiera probablement un jour, c’est l’équivalent musical de la position fœtale : un bond en arrière vers un monde différent, celui dans lequel tu commençais à remplacer les carambars par des Marlboro, celui dans lequel tu devenais le King dès que tu avais un Quentin de La Tour dans ton portefeuille Tann’s ou un nouveau CD à ajouter aux douze ou treize qui constituaient ton malheureux début de collection, celui dans lequel chaque premier samedi du mois tu arpentais le centre-ville tête haute en parlant trop fort, accompagné de tes voyous de copains qui pensaient être lookés comme
Slash ou Axl Rose mais qui, avec le recul, ressemblaient plutôt à des gitans hirsutes qui auraient réussi à chouraver des santiags Go West et des Nike montantes, le monde dans lequel une nouvelle cassette de Hard FM, une barre de Yes et un Newlook suffisaient à ton bonheur...
Certes, «
The Grand Illusion» transpire le trop propre, les beaux sentiments : c’est niais, idéaliste, trop arrangé, trop bien exécuté, démodé... Mais qu’est-ce que c’est bon ! Et ça, malheureusement, rares seront les rockheads du XXI° siècle aptes à le percevoir, la génération du futur se formatant à des sons plus rugueux qu’elle consomme par gigaoctets telle une oie au gavage. Une surculture/déculture qui rend paradoxalement les opus de Classic Rock plus inaccessibles, moins compréhensibles aux oreilles de ces mélomanes d’un genre nouveau que n’importe quel album de
Death Tech’ ou de Black UG…
Brave New World. Que tous ces fakes blasés, qui zapperont d’un clic méprisant le premier morceau après quelques mesures pour «découvrir» un nouveau groupe sur Deezer ou YouTube s’enfoncent leur pseudo-culture jusqu’au fond du colon et laissent aux initiés les plaisirs de ce full-length au charme suranné porté par le tandem Shaw / DeYoung. Tant pis pour vous mes gueules, vous ne connaîtrez jamais l’extase de vous identifier à l’homme égaré du sublime «
Man In The Wilderness», vous ne serez jamais transportés par le rythme rampant de «Castle Walls» et son break mystique; vous ne prendrez pas la mer sous les ordres du Capitaine Dennis en chantonnant «Come Sail Away» dont l’intro rappelle d’ailleurs curieusement l’insupportable ballade «Sailing» popularisée par
Rod Stewart en 1975, vous n’imaginerez pas non plus naïvement du haut de vos 12/13 ans avoir atteint le summum de la violence avec le riff teigneux de «Miss
America» chanté par
James Young pour plus d’agressivité et vous ne découvrirez pas ébahi en cours d’Arts Pla que la pochette de votre disque préféré était une relecture du «Blanc-Seing», illusion optique peinte en 1965 par le surréaliste René Magritte. Non vous passerez à côté de tout ça, et c’est probablement une bonne chose pour votre réputation si vous envisagez quelques séjours chez Oncle Sam dans les années à venir, puisque
Styx est aux USA l’équivalent de notre Michel Sardou national, et qu’il est évidemment de bon ton de balancer des vannes sur les anciens succès du gang de
Chicago, «Come Sail Away» étant à l’Amérique ce que «La Maladie D’Amour» ou «Les Lacs Du Connemara» sont à la France. On a le pays qu’on mérite…
Magritte, qu’il était très in à l’époque de détourner (
Jeff Beck, les Stones,
Mike Oldfield,
Roger Daltrey), montre au travers du «Blanc-Seing» la duperie des images, la mystification d’une réalité qui n’est bien souvent pas celle que l’on croit être : la vérité est ailleurs, trust no one, etc…. L’artwork signé des mythiques Stanley Mouse / Alton Kelley (Hendrix, Big Brother & The Holding Company, et surtout
Grateful Dead) renvoie donc un bel écho à la title-track de l’album qui reprend cette thématique par le biais de la soi-disant vie de rêve des rockstars : “Wishing secretly you were a star / But don't be fooled by the radio, the TV or the magazines / They show you photographs of how your life should be, but they're just someone else's fantasy / So if you think your life is complete confusion because you never win the game / Just remember that it's a grand illusion / And deep inside we're all the same…” Un texte on ne plus autobiographique puisque derrière les sourires de façade et les succès du groupe qui s’enchaînent aux Billboard pendant plusieurs années, les membres de
Styx vivent de violents drames personnels… John (
RIP 1948-1996) sombre dans l’alcoolisme qui l’emporte à 47 ans. Son frère Chuck mène quant à lui une lutte différente, intérieure, et ce depuis sa plus tendre enfance : il refoule son homosexualité (d’où son année chez les curés) qu’il mettra toute sa vie à accepter, la cachant à ses proches et surtout au public pendant plus de 30 ans pour ne sortir du placard qu’en 2001 avec le sida en poche accompagné d’un cancer de la prostate… Dennis, Tommy et
James donnent pour leur part dans un Enfer ma foi plus simple mais tout aussi insupportable : ils ne peuvent tout bonnement pas se blairer, bien qu’évidemment condamnés à vivre en permanence les uns sur les autres dans des espaces restreints… Même la maturité ne viendra pas à bout de leurs querelles et rivalités puisqu’après une courte reformation au milieu des 90s, Dennis est de nouveau éjecté du groupe par ses bandmates. Il tourne d’ailleurs aujourd’hui sous un pathétique nom de seconde zone (
The Music Of
Styx), à l’instar des renégats de Saxon,
Whitesnake ou Queensrÿche. La face cachée du Rock’N’Roll… Just remember that it's a grand illusion / And deep inside we're all the same….
Œuvre d’un autre temps pleurant sa gloire éphémère, passée des multidiffusions radio internationales à l’autoradio CD de quelques rares berlines conduites pour la plupart par des cinquantenaires obèses et chauves; conspuée mondialement dans South Park et les Simpsons, et désormais condamnée à alimenter les bacs à vinyles des second-hand-stores et autres brocantes américaines, «
The Grand Illusion» est pourtant un disque fort. Il convient donc contre vents et marées de le réhabiliter pour les quelques passionnés qui pourraient réussir à gratter la couche de son vernis démodé afin de toucher du doigt l’excellence de ses titres enfantés par les bandmates / ennemis jurés Tommy Shaw et Dennis DeYoung. Que leur musique vive la tête haute ! Cols-pelle-à-tarte power !
Quant aux quelques fans de
Styx encore vivants, qu’ils sortent comme Chuck du placard; vous n’êtes pas seuls les gars! (mais presque…) Et merde tiens, je me suis encore pris un radar !

 Styx : The Grand Illusion
Styx : The Grand Illusion












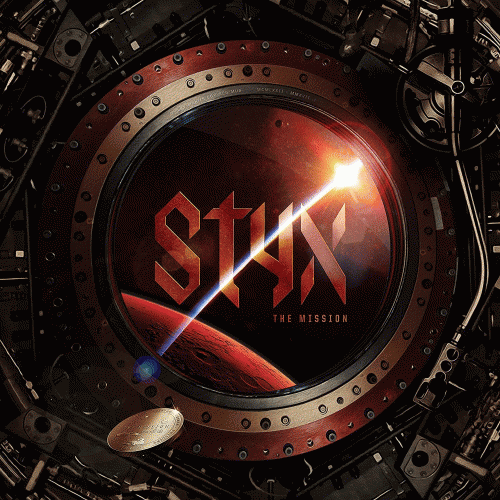
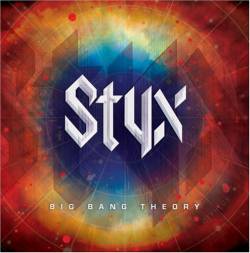
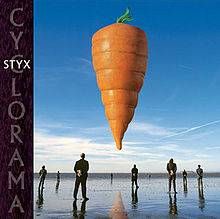

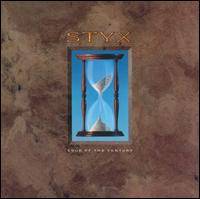





Vous devez être membre pour pouvoir ajouter un commentaire