Chronique @ ZazPanzer
Radio Nostalgie ...
Fut un temps, pas si lointain, où l’on se lavait en sifflotant avec du gel douche plein de paraben, où l’on mâchait paisiblement du chewing-gum sucré, où l’on fumait sans être regardé avec un mélange de colère, mépris et indignation, comme un criminel de guerre sur le point d’être arrêté, un temps où les étiquettes «light» ne polluaient pas les supermarchés pour donner bonne conscience aux consommateurs en surpoids qui en remplissent stupidement leurs caddies avant de se ruer dans le premier Mac Donald’s de la galerie marchande; un temps d’ailleurs où les franchises qui transforment la planète en un lieu où références et rEPères deviennent universels, lisses et tristes, n’en étaient qu’à leur balbutiement.
Reims, en cette année 1991, était épargnée pour quelques années encore du rattachement au Monde-de-la-Pensée-Unique-et-Cucul, puisque le Quick de la place d’Erlon s’appelait Free Time, le Rock Store et le Tigre étaient encore des boîtes branchées, la pitoyable Fnac où les soi-disant vendeurs ne connaissent ni Queen ni Gallagher n’existait pas, pour le plus grand bien des mélomanes et musiciens qui achetaient leurs galettes à La Clé de Sol sur les conseils avisés de Big Fat Phil (toujours contredit par Fred-de-Lust invariablement présent dans les rayons), et essayaient des grattes au sous-sol de cette même Clé de Sol en discutant avec Dom-de-My-Laï au lieu d’aller s’embouteiller dans la zone industrielle de Cormontreuil, dans laquelle venait de s’installer le premier Décathlon de la région…
La technologie finissant toujours par rejoindre la province, le Gaumont du centre s’équipa pour la sortie de Terminator 2 du son Surround 5.1, fit une pub monstre sur comment on allait s’en prendre plein la gueule, et attira le jour J environ 100% des jeunes rémois qui désertèrent du coup les deux autres cinémas. Le Lion d’Or ne s’en remit pas.
C’est dans cette salle refaite à neuf et remplie jusqu’au dernier siège que je m’installai ce 16 octobre 1991, très certainement muni d’un paquet de Mi-Cho-Ko de La Pie Qui Chante, pour assister aux aventures futuristes de la superstar Arnold Schwarzenegger chargé de protéger le jeune Edward Furlong et sa maman Sarah Connor, traqués par le redoutable T-1000, que Robert Patrick incarna entre deux beuveries avec Vince Neil.
Même si avec le recul, il faut bien avouer que ce blockbuster n’est pas le chef d’œuvre absolu qu’il me parut être après ces deux heures à s’extasier sur les effets spéciaux dorénavant désuets et à se retourner bêtement, l’air incrédule, à chaque déflagration de mitraillette ou autre explosion d’hélicoptère sortant des enceintes placées au fond de la salle, c’est toujours avec émotion que j’y rEPense.
C’est en effet au moment où Furlong et son pote envoient royalement chier le beau-père devant le garage du pavillon familial californien, que pour la première fois mes oreilles se délectèrent (en 5.1 !) de la musique des Guns, «You Could Be Mine» sortant à plein tube de leur ghetto-blaster avant qu’ils ne s’élancent sur une 80 cm3 trafiquée à la recherche d’un distributeur de cash à braquer pour pouvoir aller s’éclater dans une galerie de jeux d’arcades… Le frisson ressenti lors de cette scène culte fut tel qu’une fois le méchant T-1000 fondu et les lumières rallumées, alors que la majeure partie de la salle se releva d’un seul homme pré-pubère pour commander un cheeseburger au Free Time en face, je restai assis, scrutant l’écran à la recherche de la référence du morceau qui rEPassait dans le générique, concentré malgré les «Hasta la Vista Baby» retentissants dans mes oreilles, scandés par d’innombrables adolescents hypnotisés tels les teenagers du clip de Kiss «I Love It Loud».
Guns N’ Roses. Facile à retenir.
Quelques jours plus tard, je m’aperçus qu’il existait un single de cette tuerie, et que j’allais pouvoir l’écouter sur ma mini-chaîne Sony CD-double-cassette-autoreverse. Le pied. Quinze francs et quelques minutes plus tard, je m’envoyai à plein volume cette intro basse-batterie phénoménale, comparable au premier coït d’un rEPris de justice ressortant de cabane après vingt ans de zonzon, la guitare se greffant sur cette rythmique faisant monter la tension insupportablement, et explosant dans un nouvel orgasme sous la forme d’un riff béton, toujours soutenu par une deuxième guitare…
Et puis LA voix. Ce mélange de rage et de sensibilité à fleur de peau inimitable, ces cris de porc égorgé ponctuant les fins de phrasé, ces chœurs entrecoupés de frissons «Mine, mine, mine»… Coup de foudre. “I’m a cold heartbreaker fit to burn / And I’ll rip your heart in two / Then I leeeeeaaavvve you lying on the bed”…
Si le solo de ce morceau n’est pas à la hauteur d’un Sweet Child O’ Mine ou d’un Estranged que j’allais découvrir quelques semaines plus tard en m’étranglant de bonheur, la rythmique presque funky derrière la ligne de chant, et surtout le break, dans la lignée d’un «Freewheel Burning» dont j’ignorais également l’existence à l’époque, eurent sur moi un effet hypnotique. Je me rassasiai donc jusqu’à plus soif de «You Could Be Mine», d’autant que j’étais enfin tombé sur le clip, et que le look des Gunners me subjuguait au point que je décidai de laisser pousser mes cheveux et de me faire offrir des santiags, m’imaginant plus ou moins en loubard tatoué aux bras de mannequins pulpeuses dès lors que le morceau tournait en REPeat dans ma chambre.
Le plus beau restait pourtant à venir. La seconde plage, Civil War, m’avait à première écoute parue saugrenue, avec son étrange intro parlée, et je la boudai. Jusqu’à temps que je décide de lui donner une seconde chance. A ce moment, Dieu descendit dans ma chambre et dans un halo lumineux, je perçus la Vérité.
Toujours cette voix d’Axl si particulière, vectrice d’émotions dont on ne peut soupçonner la profondeur avant de s’y plonger cœur et âme, portée cette fois par une mélodie lancinante, puis ces lyrics «Look at your young men fighting / […] Look at your young men dying / The way they’ve always done before» que quelques écoutes suffisent à mémoriser pour le restant d’une vie ; cet accord saturé soudain transperçant la Nuit et tout ce que l’on avait un jour cru vrai; cette voix de nouveau, suivie d’un chorus à la Wah hypnotisant, et d’un break à pleurer (la voix doublée) dont je m’approprierai les propos «And in my first memories / They shot Kennedy / I went numb / When I learned to see […] That you can’t trust Freedom / When it’s not in your hands/ When everybody’s fighting for their Promised Land » dans un de mes devoirs d’anglais, rendant une copie double à la prof qui ne m’avait demandé que quelques lignes et qui se demandait ce qui clochait chez moi, si elle avait affaire à Charlie Babbit ou à un descendant dégénéré d’Albert Einstein; et enfin cette accélération finale sublimée par les touches de piano à la Elton John, et ce final apocalyptique sous fond d’orage qui ne peut qu’évoquer le Riders On The Storm des Doors, et qui achève de nous mettre à genoux devant autant de génie déployé en sEPt minutes si intenses.
Contrairement au film, vingt ans après, je ne me suis toujours pas remis de sa bande son, et pour toujours je resterai reconnaissant au groupe «le plus dangereux du monde» de m’avoir fait rentrer encore plus profondément dans le Monde-Qui-Permet-de-s’échapper-du-Monde, celui de la Musique et de la Poésie, qui nourrissent notre âme, car même si c’est un cliché de le dire, c’est aussi un fait concret, notre société pourrit et s’avilit [Look at the world we’re killing / The way we’ve always done before], et je plains ceux qui sont ancrés en permanence dans cette réalité sordide. Que le T-800 les protège.
Reims, en cette année 1991, était épargnée pour quelques années encore du rattachement au Monde-de-la-Pensée-Unique-et-Cucul, puisque le Quick de la place d’Erlon s’appelait Free Time, le Rock Store et le Tigre étaient encore des boîtes branchées, la pitoyable Fnac où les soi-disant vendeurs ne connaissent ni Queen ni Gallagher n’existait pas, pour le plus grand bien des mélomanes et musiciens qui achetaient leurs galettes à La Clé de Sol sur les conseils avisés de Big Fat Phil (toujours contredit par Fred-de-Lust invariablement présent dans les rayons), et essayaient des grattes au sous-sol de cette même Clé de Sol en discutant avec Dom-de-My-Laï au lieu d’aller s’embouteiller dans la zone industrielle de Cormontreuil, dans laquelle venait de s’installer le premier Décathlon de la région…
La technologie finissant toujours par rejoindre la province, le Gaumont du centre s’équipa pour la sortie de Terminator 2 du son Surround 5.1, fit une pub monstre sur comment on allait s’en prendre plein la gueule, et attira le jour J environ 100% des jeunes rémois qui désertèrent du coup les deux autres cinémas. Le Lion d’Or ne s’en remit pas.
C’est dans cette salle refaite à neuf et remplie jusqu’au dernier siège que je m’installai ce 16 octobre 1991, très certainement muni d’un paquet de Mi-Cho-Ko de La Pie Qui Chante, pour assister aux aventures futuristes de la superstar Arnold Schwarzenegger chargé de protéger le jeune Edward Furlong et sa maman Sarah Connor, traqués par le redoutable T-1000, que Robert Patrick incarna entre deux beuveries avec Vince Neil.
Même si avec le recul, il faut bien avouer que ce blockbuster n’est pas le chef d’œuvre absolu qu’il me parut être après ces deux heures à s’extasier sur les effets spéciaux dorénavant désuets et à se retourner bêtement, l’air incrédule, à chaque déflagration de mitraillette ou autre explosion d’hélicoptère sortant des enceintes placées au fond de la salle, c’est toujours avec émotion que j’y rEPense.
C’est en effet au moment où Furlong et son pote envoient royalement chier le beau-père devant le garage du pavillon familial californien, que pour la première fois mes oreilles se délectèrent (en 5.1 !) de la musique des Guns, «You Could Be Mine» sortant à plein tube de leur ghetto-blaster avant qu’ils ne s’élancent sur une 80 cm3 trafiquée à la recherche d’un distributeur de cash à braquer pour pouvoir aller s’éclater dans une galerie de jeux d’arcades… Le frisson ressenti lors de cette scène culte fut tel qu’une fois le méchant T-1000 fondu et les lumières rallumées, alors que la majeure partie de la salle se releva d’un seul homme pré-pubère pour commander un cheeseburger au Free Time en face, je restai assis, scrutant l’écran à la recherche de la référence du morceau qui rEPassait dans le générique, concentré malgré les «Hasta la Vista Baby» retentissants dans mes oreilles, scandés par d’innombrables adolescents hypnotisés tels les teenagers du clip de Kiss «I Love It Loud».
Guns N’ Roses. Facile à retenir.
Quelques jours plus tard, je m’aperçus qu’il existait un single de cette tuerie, et que j’allais pouvoir l’écouter sur ma mini-chaîne Sony CD-double-cassette-autoreverse. Le pied. Quinze francs et quelques minutes plus tard, je m’envoyai à plein volume cette intro basse-batterie phénoménale, comparable au premier coït d’un rEPris de justice ressortant de cabane après vingt ans de zonzon, la guitare se greffant sur cette rythmique faisant monter la tension insupportablement, et explosant dans un nouvel orgasme sous la forme d’un riff béton, toujours soutenu par une deuxième guitare…
Et puis LA voix. Ce mélange de rage et de sensibilité à fleur de peau inimitable, ces cris de porc égorgé ponctuant les fins de phrasé, ces chœurs entrecoupés de frissons «Mine, mine, mine»… Coup de foudre. “I’m a cold heartbreaker fit to burn / And I’ll rip your heart in two / Then I leeeeeaaavvve you lying on the bed”…
Si le solo de ce morceau n’est pas à la hauteur d’un Sweet Child O’ Mine ou d’un Estranged que j’allais découvrir quelques semaines plus tard en m’étranglant de bonheur, la rythmique presque funky derrière la ligne de chant, et surtout le break, dans la lignée d’un «Freewheel Burning» dont j’ignorais également l’existence à l’époque, eurent sur moi un effet hypnotique. Je me rassasiai donc jusqu’à plus soif de «You Could Be Mine», d’autant que j’étais enfin tombé sur le clip, et que le look des Gunners me subjuguait au point que je décidai de laisser pousser mes cheveux et de me faire offrir des santiags, m’imaginant plus ou moins en loubard tatoué aux bras de mannequins pulpeuses dès lors que le morceau tournait en REPeat dans ma chambre.
Le plus beau restait pourtant à venir. La seconde plage, Civil War, m’avait à première écoute parue saugrenue, avec son étrange intro parlée, et je la boudai. Jusqu’à temps que je décide de lui donner une seconde chance. A ce moment, Dieu descendit dans ma chambre et dans un halo lumineux, je perçus la Vérité.
Toujours cette voix d’Axl si particulière, vectrice d’émotions dont on ne peut soupçonner la profondeur avant de s’y plonger cœur et âme, portée cette fois par une mélodie lancinante, puis ces lyrics «Look at your young men fighting / […] Look at your young men dying / The way they’ve always done before» que quelques écoutes suffisent à mémoriser pour le restant d’une vie ; cet accord saturé soudain transperçant la Nuit et tout ce que l’on avait un jour cru vrai; cette voix de nouveau, suivie d’un chorus à la Wah hypnotisant, et d’un break à pleurer (la voix doublée) dont je m’approprierai les propos «And in my first memories / They shot Kennedy / I went numb / When I learned to see […] That you can’t trust Freedom / When it’s not in your hands/ When everybody’s fighting for their Promised Land » dans un de mes devoirs d’anglais, rendant une copie double à la prof qui ne m’avait demandé que quelques lignes et qui se demandait ce qui clochait chez moi, si elle avait affaire à Charlie Babbit ou à un descendant dégénéré d’Albert Einstein; et enfin cette accélération finale sublimée par les touches de piano à la Elton John, et ce final apocalyptique sous fond d’orage qui ne peut qu’évoquer le Riders On The Storm des Doors, et qui achève de nous mettre à genoux devant autant de génie déployé en sEPt minutes si intenses.
Contrairement au film, vingt ans après, je ne me suis toujours pas remis de sa bande son, et pour toujours je resterai reconnaissant au groupe «le plus dangereux du monde» de m’avoir fait rentrer encore plus profondément dans le Monde-Qui-Permet-de-s’échapper-du-Monde, celui de la Musique et de la Poésie, qui nourrissent notre âme, car même si c’est un cliché de le dire, c’est aussi un fait concret, notre société pourrit et s’avilit [Look at the world we’re killing / The way we’ve always done before], et je plains ceux qui sont ancrés en permanence dans cette réalité sordide. Que le T-800 les protège.













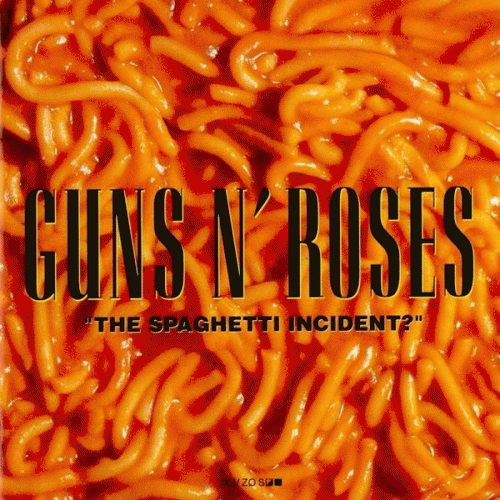


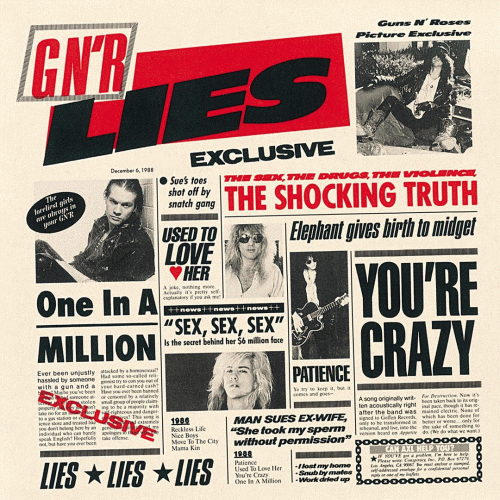

Vous devez être membre pour pouvoir ajouter un commentaire